Â
L'offensive
contre les fondements
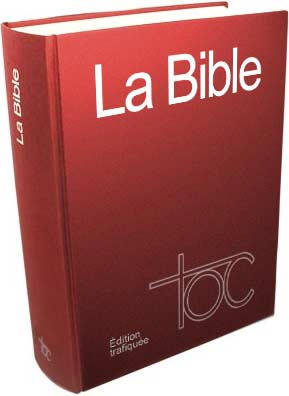
Par Michael de Semlyen
Par quelques notes dans la Bible, l'Ant�christ cessait d'�tre la papaut�, sauf pour quelques groupes chr�tiens marginaux...
L'apostasie qui s'est manifest�e au cours du vingti�me si�cle, les compromis sur les questions cruciales, et l'offensive contre les fondements de la foi remontent en fait au dix-neuvi�me si�cle. La Grande-Bretagne jouissait alors d'une prosp�rit� sans pr�c�dent. Politiquement puissante, elle influen�ait le monde entier et connaissait un climat g�n�ral d'optimisme. A cette �poque-l�, des chr�tiens aussi �minents et consacr�s que Livingstone, Wilberforce, et Shaftesbury apportaient l'Evangile aux perdus et r�alisaient des r�formes sociales en faveur des d�munis et des exclus. Non sans nostalgie, nous nous souvenons aujourd'hui des valeurs victoriennes, inspir�es par les Ecritures: � cause d'elles, nous �tions abondamment b�nis, et les autres nations nous respectaient A premi�re vue, on aurait dit qu'en ce dix-neuvi�me si�cle tout allait pour le mieux dans l'�glise. Mais les apparences �taient trompeuses. Des forces spirituelles mauvaises se d�cha�naient: des principaut�s, des puissances, et des esprits m�chants conspiraient dans les lieux c�lestes pour saper les fondements m�me de la foi.
Au cours de ce si�cle aimable et plein de bonnes intentions, le protestantisme r�form� l�galement �tabli (1) a c�d� du terrain � son ennemi jur�, apr�s avoir tenu ferme pendant des si�cles. Sur plusieurs fronts � la fois, il a subi une offensive soutenue. L'Acte d'Emancipation des Catholiques (2) adopt� en 1829 a permis aux J�suites de revenir en Angleterre. En moins de quatre ans, un mouvement catholicisant a �t� lanc� � Oxford (3). Comme nous le verrons, dans la strat�gie de la Contre-r�forme, l'anglo-catholicisme (4) va jouer un r�le crucial dans cette offensive contre les fondements de la foi r�form�e.
De toute �vidence, cette strat�gie a �t� mise en place par le Cardinal Manning (5). Voici un extrait de son discours adress� � un groupe de leaders J�suites en 1870, l'ann�e m�me o� fut promulgu� le dogme de l'Infaillibilit� Papale.
"Elle est grande, la r�compense en vue de laquelle vous luttez. Celui qui a le regard du soldat et le c�ur d'un soldat choisit intuitivement l'Angleterre comme champ de mission. Il n'en existe aucun de plus vaste ni de plus noble. Ici se trouve la t�te du protestantisme, son centre vital, la citadelle de sa puissance. L'affaiblir dans ce pays, c'est le paralyser partout ailleurs. Le vaincre en Angleterre, c'est le vaincre dans le monde entier. Une fois qu'il sera renvers� ici, toute autre guerre deviendra un point de d�tail. Toutes les routes du monde convergent en un point unique, et si l'on tient ce point, le monde entier s'ouvrira � la volont� de l'Eglise."
La Parole de Dieu a subi des attaques soutenues, tout comme au temps de la R�forme. A cette �poque-l�, les J�suites n'avaient pas encore r�ussi � g�n�raliser l'interpr�tation futuriste des proph�ties bibliques; mais remise au go�t du jour, cette interpr�tation a �t� diffus�e dans l'�glise au dix-neuvi�me si�cle, gr�ce � un flot de trait�s �manant d'une part des Fr�res de Plymouth, un nouveau mouvement (6), et d'autre part du mouvement anglo-catholique d'Oxford. Cette nouvelle interpr�tation du livre de Daniel, de la deuxi�me Ep�tre aux Thessaloniciens, et de l'Apocalypse a pos� les bases d'une fausse th�ologie de l'Antichrist, c'est � dire les bases de l'�cum�nisme moderne. Elles ne sont bibliques qu'en apparence. Pour atteindre cet objectif, on avait besoin d'une nouvelle Bible: deux savants anglo-catholiques, les Professeurs Westcott et Hort, se sont charg�s de la fournir. Une "Version R�vis�e" de la Bible a �t� cr�e � partir de manuscrits fauss�s que les R�formateurs avaient rejet�s. Presque toutes les versions modernes de la Bible sont issues de cette source impure. Dans ces versions-l�, les passages proph�tiques sur l'Antichrist sont orient�s en faveur de la nouvelle th�ologie futuriste. En 1916, Albert Close, un auteur protestant, Secr�taire de la "Protestant Truth Society" (Association Protestante pour la V�rit�) �crit: "Les J�suites ont s�duit nos professeurs de th�ologie et les ont amen�s � tirer tous leurs coups en l'air, de fa�on � bien pr�server la t�te du grand Antichrist. Ou bien leur interpr�tation est pr�t�riste, et ils situent l'Antichrist dans le pass�, ou bien elle est futuriste et ils le situent dans l'avenir. Tiraill� entre ces deux �coles, l'enseignement chr�tien est plong� dans la confusion et comme assis entre deux chaises. Rares sont les pasteurs qui pr�chent aujourd'hui sur Daniel ou sur l'Apocalypse." Naturellement, il en est de m�me � l'heure actuelle.
Il ne faut pas s'�tonner de la diffusion rapide, dans les instituts de th�ologie et dans l'�glise au sens large, de cette nouvelle interpr�tation des proph�ties bibliques, �tant donn� l'impact de la "m�thode historico-critique" (7), du darwinisme, et de l'humanisme. Parue vers 1920, la Bible d'�tudes Scofield a exerc� une influence d�terminante, surtout dans les milieux pentec�tistes. Remplie de notes savantes, elle incorpore si bien la th�ologie futuriste � son syst�me des "dispensations", que rares sont ceux qui voient la diff�rence entre cette th�ologie et la Parole inspir�e elle-m�me. Le futurisme et le syst�me des dispensations se sont largement r�pandus dans les milieux �vang�liques, surtout parmi les charismatiques. Futurisme et dispensationnalisme sont maintenant la nouvelle orthodoxie aux yeux de la plupart des chr�tiens. Du coup, l'armure spirituelle de l'�glise se trouve consid�rablement affaiblie. Dans cette optique, l'Antichrist est encore � venir, la papaut� est mise � l'abri de ses d�nonciateurs, et ceux qui veulent la r�conciliation avec Rome donnent l'impression de mettre en avant l'autorit� des l'Ecritures. Auparavant, la Contre-r�forme manifestait son hostilit� envers les h�r�tiques en entrant ouvertement en conflit avec eux. D�sormais elle a un tout autre visage, une toute autre strat�gie; et elle a une Bible �cum�nique. Le mouvement �cum�nique moderne a vu le jour � Edimbourg en 1910, avec la World Missionary Conference (Conf�rence Missionnaire Mondiale).
L'Antichrist cessait donc d'�tre la papaut� romaine, sauf pour un petit groupe de chr�tiens de moins en moins nombreux; il �tait d�sormais une figure politique qui devait gouverner le monde dans les temps de la fin. Apr�s quelques g�n�rations, les chr�tiens qui ne connaissaient que ces nouvelles versions de la Bible, et ceux qui pr�f�raient les Bibles modernes avec leur nouvelle eschatologie, seraient pr�ts � abandonner la position r�form�e, celle de la s�paration d'avec Rome. Ils seraient m�me dispos�s � en faire un sujet de repentance. Cette transformation devenait in�vitable dans le nouveau climat qui place la tol�rance et l'unit� au-dessus de la v�rit�. La situation �tait m�re pour "d�placer la borne ancienne" au sein de l'Eglise d'Angleterre. Et c'est bien ce qui a �t� fait � la Conf�rence de Keele (8) en 1967.
La Premi�re Conf�rence Evang�lique Nationale a rassembl� mille pasteurs et la�cs � Keele en avril 1967. Elle a marqu�, dit-on, le grand tournant du mouvement �vang�lique anglican au vingti�me si�cle. Trente ans plus tard, la plupart des Evang�liques qui sont encore dans l'Eglise anglicane restent tr�s satisfaits de qu'ils appellent "le grand succ�s" de Keele. Ils sont convaincus qu'enfin l�, l'unit� � laquelle ils aspiraient et pour laquelle ils avaient pri� �tait devenue r�alit�. Ceux d'entre eux qui avaient une r�putation de conservateurs se sont repentis "d'�tre rest�s en retrait" et de "s'�tre montr�s sectaires". Ils ont entam� un dialogue avec l'�glise au sens le plus large et avec le monde.
Cette Conf�rence avait �t� soigneusement pr�par�e pour aboutir � l'adoption d'une politique �cum�nique nouvelle dans l'aile �vang�lique de l'anglicanisme. Le mouvement �cum�nique �tait � pr�sent tr�s bien accueilli dans l'Eglise d'Angleterre et ailleurs. Tout �tait en place pour le lancement du "nouveau mouvement �vang�lique" au sein duquel les Evang�liques anglicans, les Anglo-catholiques et les Lib�raux ne feraient plus qu'un.
L'Archev�que de Cantorb�ry, Michael Ramsay, un Anglo-catholique, �tait l� pour ouvrir la Conf�rence. En lui, les organisateurs avaient fait un choix hautement significatif qui donnait le ton � tout le reste du d�roulement de la Conf�rence. Ramsay �tait favorable � la r�union avec Rome. En 1966 il avait officiellement rendu visite au Pape au Vatican. Pour lui, le mouvement �cum�nique tout entier �tait "le Saint-Esprit � l'�uvre en nous, nous unissant dans l'amour et nous �difiant selon la v�rit�." Il consid�rait les Evang�liques comme sectaires, voire comme h�r�tiques. Il a donc saisi cette occasion pour adresser � son auditoire captif un discours sur la n�cessit� de se rapprocher des Anglo-catholiques.
"Reconnaissons, dit-il, qu'au sein de notre Eglise anglicane, nous ne vivons peut-�tre pas tous la centralit� de la Croix exactement de la m�me mani�re. Par exemple, certains attachent plus de prix que d'autres � la confession sacramentelle ou au sacrifice de l'Eucharistie."
Les avertissements donn�s au dix-neuvi�me si�cle par l'�v�que J.C. Ryle (9) sur les p�rils de l'anglo-catholicisme retentissent encore � nos oreilles. Les Anglo-catholiques, d'abord appel�s "Tractarians" (adeptes du Mouvement d'Oxford) avaient longtemps tenu secret leur projet d'union entre l'Eglise d'Angleterre et l'Eglise de Rome. Des associations au sein de leur mouvement s'effor�aient d'�uvrer dans ce sens: "The Society of the Holy Cross" (Association de la Sainte Croix), "The Confraternity of the Blessed Sacrament" (Association du Saint Sacrement), et surtout "The Order of Corporate Reunion" (Ordre pour la R�unification en un seul Corps). Pour une large part leur activit� est rest�e secr�te. A la fin du dix-neuvi�me si�cle, le mensuel j�suite "The Month" d�clarait: "En tout cas, les ritualistes font du bon travail. Ils en accomplissent plus que ne peuvent faire les Catholiques dans l'�tat actuel du pays. Ils les ritualistes, c'est-�-dire les Anglo-catholiques pr�parent le terrain et s�ment des graines qui donneront une riche moisson, que l'Eglise catholique r�coltera t�t ou tard."
Le Cardinal John Henry Newman (10), que la plupart des Anglo-catholiques tiennent pour un h�ros et un saint, a �t� le leader le plus influent du Mouvement d'Oxford. Clifford Longley dit de lui qu'il a r�dig� l'ordre du jour du Deuxi�me Concile du Vatican depuis sa tombe. La contribution de Newman � la cause de la r�unification avec Rome est ch�re au Vatican. Tr�s vraisemblablement il deviendra le premier saint �cum�nique de l'Eglise romaine. Son passage dans le camp de Rome en 1845 a �t� alors d�crit par le futur premier ministre comme "la crise religieuse la plus grave depuis la R�forme." Que de changements sont intervenus depuis!
Au travers du mouvement anglo-catholique, la doctrine telle que Newman l'a reformul�e (� savoir que la r�v�lation n'est toujours pas close) a exerc� une influence �norme tant au-dehors de l'Eglise anglicane que dedans. Elle a fortement influenc� de nombreux Charismatiques et bien des Lib�raux, sans compter les Evang�liques! Les adeptes de l'�cum�nisme s'en sont abondamment nourris. L'essai de Newman intitul� "Le d�veloppement de la doctrine chr�tienne" a servi de manuel de base aux r�dacteurs des Accords de l'ARCIC, la Commission Internationale Anglicane-Catholique Romaine (11). L'ouvrage de Newman a donc contribu� � r�aliser cette convergence avec Rome, ce qui �tait d�j� l'objectif du Mouvement d'Oxford. Le rapport d�finitif de la Commission Internationale Anglicane-Catholique Romaine, approuv� par le Synode G�n�ral en 1986, et par la Conf�rence Episcopale Anglicane de Lambeth en 1988, assorti des "Clarifications" fournies dans le rapport de 1994, montrent que la doctrine et la pratique du pastorat anglican ont �t� reformul�es et align�es sur le Concile de Trente (12). Quand Newman s'�tait entretenu avec le Cardinal Wiseman au Vatican en 1833, il avait demand� � ce dernier sous quelles conditions l'Eglise d'Angleterre pourrait �tre accueillie et r�int�gr�e dans le bercail romain. "Par une acceptation inconditionnelle du Concile de Trente", avait r�pondu Wiseman. Aujourd'hui, au nom de l'Eglise anglicane, on a fait entrer cette acceptation dans les faits. Un seul point fait encore obstacle � la fusion (mieux vaudrait dire � la prise de pouvoir par l'Eglise romaine): c'est l'ordination des femmes.
Les organisateurs de la Conf�rence de Keele avaient-ils envisag� un tel aboutissement, et un tel succ�s pour la Contre-r�forme? Nous ne le savons pas. Mais la plupart des faits et des mises en garde solennelles �voqu�es pr�c�demment �taient s�rement bien connus des leaders �vang�liques. John Stott (13), qui pr�sidait cette conf�rence, les a �cart�es d'une chiquenaude. Lui-m�me et les autres leaders avaient d�cid� d'avance de donner satisfaction aux Anglo-catholiques. Pr�c�demment, en 1963, il y avait eu un diff�rend entre les "progressistes" et ceux qui refusaient fermement les compromis doctrinaux. Les ritualistes anglo-catholiques ont intent� une action en justice, suite � laquelle les v�tements liturgiques et les autels de pierre ont �t� l�galis�s. De nombreux R�form�s �vang�liques ont alors quitt� l'Eglise d'Angleterre. Leur d�part a facilit� d'autant la t�che de ceux qui avaient d�cid� de satisfaire les Anglo-catholiques � la Conf�rence de Keele.
Le nouveau courant �vang�lique s'ouvre � l'amour, au d�triment de la V�rit�
John Stott a averti les participants de Keele que "les Evang�liques ont une r�putation de partialit�, d'�troitesse, et que les obstructionnistes de cette esp�ce doivent se repentir et �voluer� Le premier devoir des chr�tiens divis�s est le dialogue � tous les niveaux, en passant par-dessus toutes les barri�res. Nous d�sirons entrer pleinement dans ce dialogue �cum�nique. Nous le reconnaissons: tous ceux qui confessent le Seigneur J�sus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures, et qui cherchent ainsi � vivre leur vocation commune pour la gloire du Dieu unique, P�re, Fils, et Saint-Esprit cette formulation est celle du Conseil �cum�nique des Eglises � note de l'auteur ont le droit d'�tre consid�r�s comme chr�tiens, et c'est � ce titre que nous d�sirons parler avec eux."
Cette d�claration montre clairement que la Conf�rence de Keele se voulait en communion non seulement avec les Anglo-catholiques et avec les Lib�raux, mais aussi avec les Catholiques romains. R�fl�chissons un instant � l'�normit� de cette prise de position. Il y a donc trente ans, les Evang�liques les plus respect�s de l'Eglise d'Angleterre, John Stott en t�te, ont jug� que TOUS les Catholiques romains sont sauv�s. Il est int�ressant de remarquer que trente ann�es plus tard, des Evang�liques �minents d'outre-atlantique ont fait de m�me, en apposant leur signature sur le document "Evangelicals and Catholics Together" (14).
L'influence de Billy Graham et celle du nouveau mouvement �vang�lique ont pes� sur la Conf�rence de Keele. Dans l'exercice de son minist�re qui a toutes les apparences d'une r�ussite magistrale, Graham consid�re depuis longtemps les Catholiques et les Lib�raux comme des chr�tiens avec lesquels il est en communion. Martyn Lloyd-Jones, (15) sans doute le plus grand pr�dicateur du vingti�me si�cle, a lanc� cet avertissement: "Cette entr�e dans une "communion fraternelle" chr�tienne en l'absence d'accord sur la v�rit� de l'Evangile a �branl� les convictions de beaucoup quant au sens m�me du terme "�vang�lique".
La Conf�rence de Keele a donc ratifi� un changement radical dans l'attitude des Evang�liques envers l'�cum�nisme, et elle a consid�rablement influenc� les autres d�nominations. Martyn Lloyd-Jones s'est retrouv� � la t�te de ceux qui s'�levaient contre la trahison de Keele vis-�-vis du protestantisme �vang�lique. Il estimait que loin d'avoir r�solu les principaux probl�mes de l'�glise, la Conf�rence de Keele n'avait fait que les aggraver.
Il fallait d�sormais poser des questions comme: "Qu'est-ce qu'un chr�tien?" et "Qu'est-ce que l'Eglise?" On avait abandonn� la position des R�formateurs au sujet des contrefa�ons de la foi chr�tienne; la D�claration de Keele t�moignait d'une d�valorisation de la doctrine; d�sormais il n'y avait plus d'unit� v�ritable entre Evang�liques. Alors qu'il s'adressait au "British Evangelical Council" (Conseil des Evang�liques Britanniques) en 1969, Martyn Lloyd-Jones a cit� le verset 8 du chapitre 14 de la Premi�re Ep�tre aux Corinthiens: "Et si la trompette rend un son incertain, qui se pr�parera au combat?" Il donnait un avertissement tr�s clair: non seulement l'ennemi �tait pr�sent dans le camp, mais encore il s'y d�cha�nait. "Donnez l'alarme!" s'est-il �cri�. "Donnez l'alarme!"
Il s'est retrouv� bien seul dans sa t�che d'opposant au nouveau courant unitaire. Tant de responsables qui jusqu'alors avaient partag� sa position se d�tournaient maintenant. Selon le t�moignage d'Iain Murray, entre 1963 et 1965 le Professeur J.I. Packer, (16) autrefois si proche de Martyn Lloyd-Jones, a adopt� pr�cis�ment la position qu'il avait lui-m�me d�clar�e incompatible avec la foi �vang�lique. Son ralliement � la D�claration de Keele a �t� un coup terrible pour Martyn Lloyd-Jones, qui jusque l� avait trouv� en lui un alli�.
Peu auparavant, en 1961, parlant de la doctrine "Sola Fide", c'est-�-dire de la justification par la foi seule, Jim Packer avait d�clar�: "Comme Atlas, � elle seule elle porte tout un monde sur ses �paules; elle porte en totalit� la connaissance �vang�lique de la gr�ce qui sauve." Mais il a chang� d'avis sur cette doctrine essentielle, peut-�tre � l'�poque o� il a cess� d'�tre l'alli� de Martyn Lloyd-Jones, un peu avant la Conf�rence de Keele. Son revirement n'a jamais �t� plus en �vidence que depuis le jour o� il a sign� "Evangelicals and Catholics Together", ce document qui a �branl� le mouvement �vang�lique aux Etats-Unis. En 1994, dans un article intitul� "Why I Signed It" (Pourquoi j'ai sign�) il appelle la doctrine "Sola Fide" (par la foi seule) "un paragraphe en petits caract�res". Il pose cette question: "Peut-on r�ellement affirmer, comme c'est le cas dans ce document, que ses r�dacteurs �vang�liques et ses r�dacteurs catholiques sont d'accord sur la doctrine du salut? La r�ponse est � la fois oui et non.�" "C'est non, dit le Professeur Packer, en ce qui concerne les petits caract�res." Ainsi la doctrine "Sola Fide", pour laquelle les martyrs de la R�forme ont donn� leur vie sur le b�cher, est � pr�sent rel�gu�e au rang de "paragraphe en petits caract�res."
Martyn Lloyd-Jones estimait qu'en acceptant le compromis �cum�nique, les Evang�liques anglicans �levaient leur d�nomination au-dessus de l'Evangile et d�valorisaient l'enseignement de la Bible. Au-dessus des v�rit�s scripturaires, qui risquent d'entra�ner l'affrontement, ils pla�aient la relation personnelle, l'unit� superficielle, la tol�rance et l'affection. Martyn Lloyd-Jones a encourag� les Evang�liques � quitter les d�nominations et � s'unir dans la v�rit� de la Parole de Dieu. Il pensait que la mise en �uvre de cette d�marche incombait � d'autres que lui, mais il �tait convaincu qu'elle pouvait et devait s'effectuer. Il fallait une situation claire, au lieu de cette confusion qui obscurcissait la compr�hension de l'Evangile. "Nous n'avons pas � nous demander, disait-il, ce que doit �tre une �glise territoriale, ni comment nous pouvons trouver l'unit� et la communion fraternelle, ni par quelle formule nous pouvons concilier des conceptions oppos�es. Nous avons � nous demander: "Qu'est-ce qu'un chr�tien? Comment devient-on chr�tien? Par quel moyen nos p�ch�s sont-ils pardonn�s? Qu'est-ce qu'une �glise?"
Keele avait l�gitim� le compromis consenti par les Evang�liques au sein de l'Eglise Etablie. Mais dix ans plus tard � Nottingham, la deuxi�me "National Evangelical Anglican Conference" � NEAC II (Conf�rence Nationale des Evang�liques Anglicans - II) a appos� sur le compromis le sceau de son approbation. Les organisateurs de la Conf�rence de Keele n'avaient pas voulu accueillir le mouvement charismatique �cum�nique, qui se d�veloppait en Grande-Bretagne depuis le d�but des ann�es 1960. En revanche celle de Nottingham a accord� au mouvement charismatique sa caution et ses �loges. On lit dans la D�claration de Nottingham: "Le mouvement charismatique est particuli�rement significatif � nos yeux, car il t�moigne avec force de la pr��minence de Dieu."
C'est � Nottingham que le chef de file charismatique David Watson a affirm� que la R�forme avait �t� �l'une des plus grandes trag�dies de l'histoire de l'Eglise�. Il a aussi expliqu� aux participants qu'il en �tait arriv� � ressentir la douleur profonde que Dieu doit �prouver devant les s�parations dans son corps.
Le mouvement du Renouveau Charismatique avait commenc� aux Etats-Unis dans les ann�es cinquante et s'�tait rapidement propag� dans le monde chr�tien. Il y avait un large consensus pour le consid�rer comme une �uvre magistrale du Saint-Esprit, comme une nouvelle Pentec�te. Des groupes interd�nominationnels comme le "Mouvement des Hommes d'Affaires du Plein Evangile" r�unissaient Catholiques et Protestants dans ce qu'ils appelaient "l'unit� de l'Esprit", sous la banni�re "de l'amour". Ils mettaient l'accent sur le t�moignage v�cu et non sur les Ecritures.
Moins de deux ans avant la Conf�rence de Keele, le Deuxi�me Concile du Vatican avait accord� sa b�n�diction � ce qu'il �tait convenu d'appeler une nouvelle action du Saint-Esprit. Il �tait d�sormais possible "d'accueillir les fr�res s�par�s retournant au bercail", comme le Cardinal B�a l'avait annonc� aux participants de la session de 1965. Les "h�r�tiques" �taient d�sormais des "fr�res s�par�s". A condition d'abandonner la saine doctrine biblique, ils pouvaient � nouveau �tre re�us dans le sein de leur "Eglise m�re". Le Vatican a officiellement adopt� son propre mouvement de renouveau. Dans quelle mesure ce mouvement �tait-il spontan� ou planifi�? Nous l'ignorons. Mais comme il mettait fortement l'accent sur les dons et sur l'exp�rience personnelle, il contribuait incontestablement � gommer les diff�rences doctrinales. A l'instar de ce qu'on avait d�j� fait dans les croisades de Billy Graham, il mettait en �vidence ce que ce dernier appelle "le r�le de nos fr�res catholiques dans la famille chr�tienne." Les catholiques ayant retrouv� le statut de "fr�res" dans le c�ur et la pens�e d'une multitude d'Evang�liques, une br�che �tait d�sormais ouverte dans la forteresse de la s�paration biblique. A la Conf�rence de Keele on avait capitul� devant les forces des "nouveaux Evang�liques". Celle de Nottingham a rendu cette capitulation inconditionnelle.
Il semblait impossible de r�sister � l'�lan donn� par ces deux Conf�rences et par les forces des "nouveaux Evang�liques". Un nouvel esprit de tol�rance et "d'amour" mettait hors la loi les d�bats sur les v�rit�s bibliques. L'objectif, c'�tait l'unit�; et dans cette unit� acquise au prix du compromis doctrinal, on voyait la volont� de Dieu pour la transformation de l'�glise. La th�ologie r�form�e, avec ses grandes doctrines de la gr�ce, n'�tait d�sormais bonne que pour quelques pass�istes attard�s qui s'obstinaient encore � livrer des combats absurdes derri�re des murailles croulantes. Les Evang�liques conservateurs qui refusaient l'�cum�nisme ont �t� marginalis�s, tax�s d'intol�rance et de manque d'amour.
La d�cision prise � Keele par la majorit� des Evang�liques, cette entr�e dans le dialogue �cum�nique a �t� lourde de cons�quences spirituelles. Le plus �tonnant, c'est que ce revirement radical est le fait de ceux qui auraient �t� les mieux plac�s pour en comprendre les implications, et qu'il y ait eu si peu de protestations s�rieuses! On peut r�ellement affirmer que les Evang�liques ont alors cess� d'�tre �vang�liques. Pour eux la doctrine a perdu sa place �minente et a �t� rel�gu�e � une position inf�rieure. On a d�pouill� les Ecritures de leur autorit� supr�me; on a cess� de consid�rer la Parole de Dieu comme infaillible. De toute �vidence, le remplacement de la "Version Autoris�e" (la "King James") par des versions modernes a jou� un r�le consid�rable. On n'entend plus proclamer "Ainsi parle le Seigneur", mais: "Cela d�pend de la traduction que vous avez." Il y a l� comme un �cho de la parole par laquelle le serpent avait sem� le doute: "Dieu a-t-il vraiment dit...?"
Apr�s Keele, sur une pente de plus en plus glissante, on est tomb� de plus en plus bas. Les cons�quences sont manifestes dans l'Eglise anglicane et aussi dans les autres d�nominations protestantes. Au cours des trois derni�res d�cennies, l'Eglise anglicane a subi une transformation si radicale et si profonde, que cette grande institution semble avoir perdu jusqu'� son identit�. L'effondrement du protestantisme � Keele et � Nottingham laisse le champ libre aux "nouveaux Evang�liques". Il a acc�l�r� la d�valuation de la doctrine. Nous avons "d�plac� la borne ancienne" que nos p�res avaient plac�e (Proverbes 23:10). Leur confession de foi �tait contenue dans les "Trente-neuf Articles" de l'Eglise d'Angleterre (17). Oui, vraiment, cette pri�re de Jo�l est d'actualit� pour l'�glise de notre nation: "Eternel, �pargne ton peuple! Ne livre pas ton h�ritage au d�shonneur, pour qu'il soit la fable des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples: O� est leur Dieu?" (Jo�l 2:17). Elle est d'actualit� pour ses �v�ques, pour ses pr�tres, et pour ses la�cs: ils sont si nombreux � ne plus bien savoir ce qu'ils croient. Telles sont les questions que se pose la nation, voyant cette communaut� jadis auguste qui est maintenant tomb�e si bas.
Depuis Keele et les ann�es qui ont suivi, il n'y a plus de borne ancienne. Notre h�ritage a �t� livr� au d�shonneur. Il y a eu trahison. Nous avons m�pris� l'h�ritage de ceux qui avaient sacrifi� leur vie pour les v�rit�s de la Parole de Dieu. Le verdict de Keele et de Nottingham, c'est que les martyrs de la R�forme se sont tromp�s et ont �t� les complices du plus grand malheur qui soit jamais survenu dans l'�glise. Pour presque tous, "la flamme de Hugh Latimer" (18) s'est �teinte, et on a d�savou� le sang des martyrs.
Dans les �glises libres, il n'en va pas autrement. Ces �glises libres ont perdu leur libert�, et ont pratiquement abandonn� le non-conformisme. Le conformisme r�gne: on se veut conforme � l'esprit du si�cle, cet esprit de tol�rance et d'unit�. M�me la d�nomination baptiste a succomb� � cet esprit s�ducteur, elle qui �tait solidement fond�e sur la Bible. Se laissant porter par le courant issu de Keele, et qui est pr�sent un fleuve, l'Union Baptiste a peu � peu modifi� sa position: en 1995, �crasant les opposants qui restaient, elle a vot� � une forte majorit� pour la participation sans r�serve � "Churches Together in England" (Eglises ensemble en Angleterre) (19).
Bien peu rappellent le souvenir des martyrs de la R�forme
Le nouveau courant �vang�lique s'est ouvert � un amour qui fait l'�conomie de la v�rit�. Cet amour-l� n'est pas celui de l'�pouse de Christ: c'est celui de la prostitu�e d'Apocalypse 17. O� sont maintenant l'amour de la v�rit�, l'attachement jaloux � la puret� doctrinale, et la haine de l'idol�trie? Dans l'�glise �cum�nique actuelle, o� donc est le souci br�lant pour les �mes de plus de mille millions de Catholiques, d'Orthodoxes, et d'Anglicans qui sont priv�s de l'assurance du salut, et asservis � des sacrements fond�s sur un syst�me d'�uvres et de rituels? O� sont les c�urs compatissants envers les chercheurs de v�rit� qui restent captifs du mensonge? Qui �l�vera la voix pour que l'�glise soit purifi�e, pour que nous nous repentions profond�ment de les avoir abandonn�s en faisant semblant de ne pas les voir, eux qui sont de notre parent�? O� sont-ils, les pr�dicateurs qui s'abstiennent d'�carter le message limpide d'Apocalypse 17, "l'homme de p�ch�", le "myst�re de l'iniquit�" dans 2 Thessaloniciens 2, et la "petite corne" de Daniel 7, au temps du quatri�me royaume, cette corne que le proph�te a vue "faire la guerre aux saints du Tr�s Haut" et "l'emporter sur eux"? O� sont les veilleurs qui devraient donner l'alarme? Et ceux qui entendent la trompette, pourquoi ne se laissent-ils pas avertir?
Il faut le reconna�tre: dans ce pays qui a re�u un h�ritage si pr�cieux, tr�s peu de pasteurs consentent � rappeler le souvenir des martyrs du seizi�me et du dix-septi�me si�cle. Rarissimes aujourd'hui sont ceux qui restent attach�s � la cause d�fendue par ces martyrs, pour qui le sacrifice de la Messe �tait un blasph�me �pouvantable, et la Papaut�, l'Antichrist.
La R�forme a donn� aux chr�tiens deux grandes v�rit�s: premi�rement, le juste vivra par la foi (et non par les �uvres du syst�me romain ou d'une autre religion quelle qu'elle soit); deuxi�mement, ainsi que l'Ecriture le r�v�le, la Papaut� est l'Antichrist. Si nous renon�ons � la deuxi�me de ces v�rit�s, nous perdons in�luctablement une partie de la premi�re. C'est parfaitement manifeste aujourd'hui. Les pasteurs ne veulent pas pr�cher sur ce sujet: ils craignent la d�sapprobation des hommes, mais ils feraient mieux de craindre la d�sapprobation de Dieu. Rares sont ceux qui tournent le dos � la popularit� et sont pr�ts � sacrifier leur r�putation � ne parlons pas de leur vie. Mais comme l'on dit, "le mal abonde quand les hommes de bien se taisent."
Lors de son intronisation archi�piscopale � Cantorb�ry en 1991, George Carey a mentionn� ses pr�d�cesseurs, et certains archev�ques qui avaient subi le martyre. Il a parl� d'Alphege (20), un moine b�n�dictin, et de Thomas Becket (21), tous deux canonis�s par l'Eglise catholique romaine. Ensuite il a parl� de William Laud. Becket et Laud ont l'un et l'autre cherch� � ramener l'Eglise d'Angleterre sous l'autorit� de l'Eglise de Rome, et � faire adopter par les Anglais la foi et les pratiques romaines. Dans la liste des martyrs nomm�s par George Carey, le nom de Thomas Cranmer (22) brille par son absence. Avec une discr�tion extr�me, on avait comm�mor� le cinq centi�me anniversaire de son martyre un an auparavant. Au cours de son intronisation, George Carey a d� s'engager � d�fendre les 39 Articles et le "Book of Common Prayer" (23), que par la gr�ce de Dieu, nous devons essentiellement � Thomas Cranmer. Mais l'Archev�que semble avoir pris bien � la l�g�re cette promesse de d�fendre les 39 Articles et le "Book of Common Prayer". Lors de sa derni�re visite au Pape dans la cit� du Vatican, il faut reconna�tre que George Carey a fait quelques remarques favorables � la R�forme; mais il n'en continue pas moins � rechercher la pleine unit� avec l'Eglise romaine. Cette ambivalence est typique du probl�me des conducteurs dans l'�glise d'aujourd'hui: centr�s sur l'homme, ils sont parfaitement incoh�rents.
Comme l'Ap�tre Paul l'�crivait aux Galates: "Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je d�sire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche � plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ" (Galates 1:10)
Cette m�me ambivalence et cette m�me incoh�rence sont manifestes dans le "Cours Alpha" qui se r�pand comme une tra�n�e de poudre, non seulement au Royaume-Uni, mais encore aux Etats-Unis, au Canada et dans les pays francophones. L'esprit est le m�me que celui de Keele: on passe sous silence les diff�rences doctrinales. Des th�ologiens catholiques cautionnent ce cours: soutenus par le cardinal Hume, ils disposent de leur propre version catholique. Le cours Alpha �mane de l'�glise "Holy Trinity" � Brompton Road, la premi�re au Royaume-Uni � avoir accueilli la "B�n�diction de Toronto" et � avoir subi l'impact des "Proph�tes de Kansas City". Tout comme le document "Evangelicals and Catholics Together" aux Etats-Unis, le Cours Alpha amalgame habilement des r�alit�s inconciliables. De m�me, le mouvement des "Promise Keepers", import� aussi des Etats-Unis, et lanc� en Angleterre en novembre 1997, met en place des ponts d�pourvus de fondements.
Les cons�quences de la capitulation �cum�nique, � Keele et ailleurs, sont particuli�rement manifestes sur le plan national comme sur le plan eccl�sial. Puisqu'on lui laisse toute latitude, l'Eglise romaine, avec sa ma�trise parfaite des m�dias, est pr�te � prendre le pouvoir l� o� bient�t l'Eglise d'Angleterre sera irr�m�diablement d�sint�gr�e. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure les agents de Rome s'emploient � acc�l�rer ce processus; mais les enseignements de l'histoire sont l� pour montrer jusqu'o� les disciples du Pape sont pr�ts � aller pour promouvoir la cause de "leur m�re l'Eglise". Le journal "Catholic Herald" en est suffisamment assur� pour publier la pr�diction suivante: "les jours de l'Eglise anglicane sont compt�s, et la plupart de ses membres reviendront � la foi de leurs lointains anc�tres de l'�poque m�di�vale." D'ailleurs beaucoup sont d�j� revenus, au moins en esprit.
Un peu plus t�t au cours de cette ann�e, la une du "Times" et celle du "Daily Telegraph" annon�aient que l'Eglise anglicane avait pris des dispositions pour ramener en Angleterre un pr�t consenti par Rome: les reliques de Thomas Becket. A l'�poque de la R�forme, on les avait emport�es � Rome pour les mettre � l'abri. Ces fragments d'os et de tissu c�r�bral seront les premi�res reliques � �tre pr�sent�es au public dans la cath�drale de Cantorb�ry depuis la R�forme.
Le tombeau de Thomas Becket � Cantorb�ry, ainsi que la pr�sence spirituelle de ce "saint" de l'Eglise catholique romaine dans la primatiale anglicane ont d�j�, et continueront d'avoir, une grande port�e pour le mouvement �cum�nique. En 1982 le Pape Jean-Paul II et l'Archev�que Runcie ont pri� ensemble sur le tombeau de Becket. En 1989, l'Archev�que d'York, John Hapgood, a conduit p�lerinage interreligieux dans cette cath�drale. Les trois d�l�gations de ce p�lerinage parfaitement �cum�nique venaient de se retrouver dans un autre "lieu saint": le "site sacr�" o� le roi Henry II avait fait p�nitence en pr�sence du pape � la suite du meurtre de Thomas Becket en 1170. Le 29 d�cembre on c�l�bre dans tout le pays des offices comm�morant le "martyre" de Becket, avec une large couverture m�diatique. Becket est devenu "martyr" pour avoir accord� son all�geance � la Papaut� et non � la Couronne. On peut fort bien se servir de lui pour restaurer le principe selon lequel l'Etat ne doit pas avoir autorit� sur l'Eglise.
L'image publique de Thomas Becket, dans sa vie comme dans sa mort, a subi en ce si�cle �cum�nique de profondes modifications, gr�ce � la pi�ce de th��tre de T.S. Eliot, "Meurtre dans la Cath�drale". C'est aussi le cas dans une mesure plus grande encore, pour l'image de Sir Thomas More, dont Foxe (24) relate qu'il flagellait et torturait dans son jardin "ceux qui se rendaient coupables de lire les Ecritures et d'adopter des doctrines purement protestantes." Le film de Robert Bolton, "A Man for All Seasons" (en VF: "Un homme pour l'�ternit�") fait de Thomas More un grand chr�tien, un homme de Dieu � la foi incomparable; mais c'est de l'histoire revue et corrig�e, de la propagande �cum�nique.
"L'Ann�e de l'h�ritage chr�tien de l'Angleterre" a d�but� en mai 1997, avec le quatorzi�me centenaire de l'arriv�e en Grande-Bretagne de Saint Augustin (25). Lors de son intronisation, l'Archev�que de Cantorb�ry a d�clar� qu'Augustin avait amen� de Rome la foi chr�tienne pour la r�pandre en Grande-Bretagne. L� encore, on est en pleine propagande �cum�nique. Il est abondamment prouv� que la foi chr�tienne avait d�j� pris racine dans les Iles Britanniques d�s la fin du premier si�cle. Des saints comme Alban et Patrick avaient �t� martyris�s ou pers�cut�s des si�cles avant qu'Augustin n'arrive pour imposer la supr�matie papale. D'apr�s ses organisateurs, cette "Ann�e de l'h�ritage chr�tien" est annonciatrice d'une "brise spirituelle nouvelle", d'un "�veil religieux", et elle inclut de nombreux p�lerinages en l'honneur des "saints" d'avant la R�forme. V�n�rer les "saints" et les reliques, c'est revenir au spiritisme et � la n�cromancie, ce que la Bible condamne. Ces choses sont n�anmoins dans le droit fil des recommandations r�centes adress�es par le Pape aux Catholiques: il leur conseille "d'invoquer leurs anc�tres d�c�d�s pour obtenir leur protection."
Cette r�gression vers le christianisme d'avant la R�forme s'acc�l�re. Elle m�ne � la superstition et � l'idol�trie. Elle b�n�ficie du ferme soutien de journalistes Catholiques particuli�rement respect�s, qui toute leur vie ont pri� pour que l'Angleterre porte � nouveau le titre de "Dot de Marie" (26). Les m�dias ont accord� une attention extraordinaire � la conversion au catholicisme de certaines personnes c�l�bres: Anne Widdecombe (27), John Gummer (28), Alan Clark (29), Charles Moore (30), et � plus forte raison encore, la Duchesse de Kent, qui est membre de la famille royale. Ils ont accord� � ces conversions une place �norme; pourtant, dans ces temps �cum�niques qui sont les n�tres, elles sont cens�es �tre sans cons�quence.
Quand le pas suivant est franchi, avec les cultes r�unissant plusieurs religions, il n'y a pas � s'�tonner. La porte une fois ouverte, tout un chacun peut entrer. Des membres �minents de la famille royale refl�tent cette tendance et font bon accueil � d'autres religions. La F�te du Commonwealth, particuli�rement cher � Sa Majest� la reine, n'a plus rien d'une f�te chr�tienne. La reine n'a tenu aucun compte des protestations de deux mille pasteurs �vang�liques qui d�plorent cette insulte envers la supr�matie et le caract�re unique du Seigneur J�sus-Christ. En 1989, le Prince Philip a lanc� un "International Sacred Literature Trust" (Trust International de la Litt�rature Sacr�e), contribution de poids au dialogue interreligieux. Le Prince Charles, h�ritier de la Couronne, qui d�clare adh�rer � "la foi plurielle" et non � "la foi" tout court, fait de grands efforts pour soutenir l'Islam. Aujourd'hui les Musulmans projettent de construire cent mosqu�es neuves en trois ans. Selon eux il s'agit de "la plus large expression de la foi religieuse en Angleterre", depuis bien des si�cles.
En novembre 1993, le Synode de l'Eglise d'Angleterre s'est inclin� devant la pens�e "politiquement correcte" en acceptant l'ordination des femmes. Le Professeur David Samuel, qui � la suite de cette mesure a renonc� � son minist�re dans l'Eglise anglicane, fait part de ses r�flexions d'alors. "Cette d�cision aura des cons�quences incalculables, dit-il. Elle montre quelle sera la trajectoire de l'Eglise d'Angleterre dans l'avenir: elle se s�parera de plus en plus de ce que prescrit l'Ecriture, de la foi orthodoxe, et de la v�rit�. Si la doctrine officielle de l'Eglise d'Angleterre peut changer arbitrairement suite � un vote � main lev�e dans un Synode, c'est qu'on a sap� ses fondements et qu'elle n'est plus que fiction." Dans quelques ann�es, il ne faudra pas s'�tonner de voir dans l'Eglise anglicane des femmes �v�ques et archev�ques.
Il faut compter aussi avec le mouvement homosexuel et lesbien dit chr�tien. Ce probl�me est d�j� r�gl� depuis des d�cennies, depuis la Conf�rence NEAC de Nottingham. "La communaut� chr�tienne doit �lever la voix pour accueillir pleinement les homosexuels chr�tiens." Cela se passait quelques mois � peine avant le lancement du "Mouvement Chr�tien Gai et Lesbien." Le vingt-cinqui�me anniversaire de ce mouvement a �t� marqu� par un culte dans la cath�drale de Southwark. Pr�s de la cath�drale, et sur le plan national, il y a eu tr�s peu de protestations. Les observateurs bien inform�s du Synode G�n�ral estiment que l'ordination d'homosexuels pratiquants est d�sormais in�luctable. L'an dernier, Robert Runcie a fait savoir que cela se faisait d�j� alors qu'il �tait Archev�que de Cantorb�ry.
D�s l'instant o� les Evang�liques ouvrent la porte au compromis et cessent de se tenir sur le roc des Ecritures, in�vitablement ils continueront � battre en retraite. Des Evang�liques tr�s en vue, et John Stott lui-m�me ont r�ussi � se convaincre qu'il n'existe pas d'enfer au sens propre du mot. Quelques ann�es plus tard, le Synode de l'Eglise d'Angleterre a officiellement "aboli" la doctrine des peines �ternelles. Cette doctrine a �t� remplac�e par l'annihilationnisme", au m�pris de deux mill�naires d'orthodoxie et des enseignements limpides donn�s par notre Seigneur dans les Ecritures. Le Synode a �galement d�cid� que la cohabitation avant le mariage n'est plus un p�ch�. Pourtant l'enseignement du Nouveau Testament sur la fornication est clair comme de l'eau de roche. Mais maintenant on a une nouvelle herm�neutique et une nouvelle fa�on d'�vang�liser. Depuis que le Synode s'est �lev� contre les enseignements limpides de la Bible, beaucoup ont d� se rappeler la question du Psalmiste: "Quand les fondements sont renvers�s, le juste, que ferait-il?" (Psaume 11:3).
Pendant ce temps, les chaires � au sens physique � disparaissent des �glises, et l'on y r�introduit le crucifix � l'entr�e du ch�ur ou en d'autres lieux. On remet � l'honneur la confession auriculaire, les "lieux saints", "l'eau b�nite". De plus en plus de pasteurs acceptent le titre de "pr�tre" ou de "P�re", au m�pris de la Bible. Les pr�dications sur la Loi se font de plus en plus rares. Dans ce nouveau climat �cum�nique, dans cette atmosph�re de fausse tol�rance, les pr�dicateurs ne veulent pas courir le risque d'offenser l'assembl�e et de perdre de leurs effectifs. Il y a de quoi r�fl�chir quand on apprend par la presse que d'apr�s un sondage r�alis� en 1997, seulement moins de 25% des pasteurs anglicans sont capables de dire quels sont les Dix Commandements. Quand on ignore la Loi, comment peut-on pr�cher l'Evangile?
Au sein de l'Eglise d'Angleterre, le "Reform Group" r�unissant des Evang�liques anglicans est compos� de ceux qui ne pouvaient adh�rer � la majorit� des d�cisions de Keele. Ils ont exprim� leur d�ception quant � l'orientation nouvelle de leur �glise en pr�conisant le non-paiement d'une partie des contributions paroissiales au budget dioc�sain. Ils continuent de s'opposer � certaines tendances antibibliques dans l'Eglise anglicane, mais ils n'ont pas de position ferme sur la question de l'ordination des femmes. Ils ne cherchent pas non plus � se s�parer du mouvement �cum�nique. Le mouvement "The Church of England (Continuing)" (L'Eglise d'Angleterre qui continue) s'est s�par� de l'Eglise anglicane apr�s le vote en faveur de l'ordination des femmes par le Synode G�n�ral en novembre 1992. Il veut pr�server l'identit� v�ritable de l'Eglise d'Angleterre en conservant la Bible "King James", les 39 Articles, le "Book of Common Prayer" et l'Ordinal. L'�v�que qui pr�side ce mouvement, David Samuel, estime que ces textes sont "la carte d'identit� de l'Eglise d'Angleterre", et que l'�glise qui les abandonne devient "un SDF de la chr�tient�".
Avant de conclure cette br�ve �tude, je dois �voquer un tr�s grave danger � la fois spirituel et politique, auquel il nous faut faire face alors que notre nouveau gouvernement et ceux qui l'influencent en coulisse affaiblissent et d�mant�lent l'Union, et s'appr�tent � nous submerger dans une Europe F�d�rale. Seul le Seigneur sait jusqu'� quel point le d�clin du protestantisme �vang�lique (dont la Conf�rence de Keele donne la mesure) est responsable de cette d�rive qui nous conduit � renoncer � notre pr�cieuse ind�pendance. Mais comme j'ai tent� de l'expliquer, nous avons trahi le pr�cieux h�ritage que nous avions re�u de Dieu; nous avons �cart� les le�ons de l'histoire et les pr�cautions que dans leur perspicacit� nos p�res avaient prises pour prot�ger notre libert�. Ces libert�s �taient pr�serv�es dans le "Bill of Rights" (31) (loi de 1689 d�terminant les droits du citoyen anglais); dans l'Acte d'Etablissement de 1701 (garantissant l'accession au tr�ne d'un monarque protestant) et dans le Serment du Couronnement (par lequel le roi ou la reine promet solennellement de prot�ger la foi r�form�e). Le plus attristant, c'est que la reine elle-m�me les �carte � pr�sent. Tout le monde semble avoir perdu de vue l'influence n�faste de la Papaut�, chaque fois qu'elle est intervenue dans les questions concernant notre nation.
Nous le savons: en tant que nation, nous m�ritons le jugement. Les Evang�liques ont renonc� � leur h�ritage protestant r�form�, et en m�me temps (ce n'est pas �tonnant) la reine et le parlement ont fait de m�me. Le jour de son couronnement, Sa Majest� a reconnu l'autorit� et la supr�matie de l'Ecriture Sainte: "Voici ce qu'il y a de plus pr�cieux en ce monde. Voici la sagesse. Voici la loi royale. Ce Livre contient les oracles vivants de Dieu", a proclam� l'Archev�que de Cantorb�ry. Alors la reine a promis de "mettre en �uvre tous ses pouvoirs pour prot�ger les Lois de Dieu, la confession v�ritable de l'Evangile, et la religion protestante r�form�e �tablie par la loi."
Autrement dit, la reine s'est engag�e � maintenir les lois et les statuts de l'Ecriture Sainte et de la foi chr�tienne. Cet engagement s'applique aussi � son r�le l�gislatif. Malheureusement, sous son r�gne, nous l'avons vue accorder son consentement � des mesures l�gislatives lourdes, enti�rement contraires � la foi chr�tienne biblique, et ouvrant tout grand la porte � l'immoralit�. Des lois facilitant le divorce, l�galisant l'avortement et l'homosexualit�, encourageant l'adult�re et la pornographie ont entra�n� la crise morale dont souffre notre soci�t� actuelle. De nombreux signes indiquent que nous r�coltons la temp�te de la juste col�re de Dieu et de Son juste jugement; on pourrait citer en tout premier lieu la d�vastation r�sultant de l'effondrement des valeurs familiales. La reine a vu ces choses se produire dans sa propre famille. Cet effondrement se produit � une allure impressionnante parce que Dieu retire Sa gr�ce et Sa b�n�diction, qui pour beaucoup d'entre nous semblaient aller de soi. Tel est le fruit de notre apostasie nationale. Nous sommes peut-�tre sur le point de payer, en tant que nation, un prix �norme.
Notre libert� religieuse est en cause. Dans son ouvrage paru en 1997, "The Principality and Power of Europe" (L'Europe: une principaut� et une puissance), Adrian Hilton �crit: "Les chr�tiens �vang�liques sont class�s dans la cat�gorie "sectes" par l'Union Europ�enne. Tout groupe qui n'appartient pas � l'�glise majoritaire (catholique romaine) devient suspect aux yeux des membres du Parlement Europ�en. Cette classification n'a rien de nouveau. L'�glise primitive passait pour �tre une secte h�r�tique, et � ce titre elle a subi tr�s t�t des pers�cutions. Naturellement, les pers�cutions � venir ne seront pas ouvertement religieuses. Pour un organisme aussi �clair� que l'Union Europ�enne, ce serait choquant. La pers�cution aura un caract�re politique, comme pour l'Eglise primitive. Les chr�tiens �vang�liques seront accus�s de "troubler l'ordre public" ou "d'inciter au sectarisme" comme ce fut le cas dans le Livre des Actes aux chapitres 16 et 17. Le d�put� europ�en David Hallam confirme qu'une r�solution europ�enne sur les sectes ou les cultes autorise Europol, la police europ�enne, � surveiller les activit�s du groupe en question. Il ajoute: "En Europe, cela pourrait concerner les chr�tiens."
Avec la capitulation du protestantisme, la chr�tient� apostate se h�te de mettre en place une religion mondiale unique. Celle-ci a un vernis superficiel, mais en fait elle n'est pas moins intol�rante et moins assoiff�e de sang que par le pass�. Quand les religions mondiales auront fusionn� avec le Nouvel Age pour �tablir un immense monopole �cum�nique regroupant les diverses religions, le petit troupeau de Dieu sera de nouveau comme les agneaux qu'on m�ne � la boucherie. Mais l'�v�que Ryle a su trouver des mots pour encourager les �vang�liques qui refusent le compromis: "La voil�, l'�glise qui accomplit l'�uvre de Christ sur la terre. Elle n'a que peu de membres, elle forme un petit troupeau: un ou deux ici, deux ou trois l�-bas; quelques-uns dans cette r�gion-ci, quelques-uns dans celle-l�. Mais ce sont eux qui �branlent l'univers; ils changent le cours des royaumes par leurs pri�res; ils sont les ouvriers diligents qui r�pandent la connaissance de la religion pure et sans tache. Ils sont le pivot du pays, le bouclier, le rempart, la colonne qui soutient leur nation, o� qu'elle se trouve." Laissons-nous donc encourager, et "tenons ferme dans la libert� pour laquelle Christ nous a affranchis".
Notes:
1. L'Acte d'Etablissement de 1701
garantissait l'accession au tr�ne d'un monarque protestant.
2. Par l'Acte d'Emancipation (Catholic Emancipation Act) les
Catholiques devenaient �ligibles au Parlement et avaient acc�s �
pratiquement toutes les charges publiques except� la monarchie.
3. Le Mouvement d'Oxford est le fait d'un groupe d'universitaires,
titulaires pour la plupart de chaires d'enseignement � Oxford, et
convertis de l'anglicanisme au catholicisme. Ils ont �t�
profond�ment influenc�s par J. H. Newman. La publication de toute
une s�rie de trait�s de 1833 � 1841, "Tracts for our Times" leur a
valu d'�tre aussi appel�s "Tractarians".
4. L'anglo-catholicisme est un courant de l'�glise anglicane qui
se veut aux antipodes de l'anglicanisme �vang�lique. Issu du
"mouvement d'Oxford", il fait siens la plupart des rites
catholiques, met fortement l'accent sur la continuit� entre
anglicanisme et catholicisme, et aspire � la r�unification entre
l'Eglise anglicane et l'Eglise catholique romaine.
5. Edward Manning (1808-1892) est pass� au catholicisme en 1851.
Pr�tre puis dignitaire catholique, il est connu pour son souci des
questions sociales et pour son soutien au dogme de
l'Infaillibilit� pontificale, promulgu� au Concile de Vatican I en
1870. Il a �t� nomm� cardinal en 1875.
6. N� � Dublin en 1821, implant� vers 1830 dans la ville de
Plymouth, le mouvement des "Fr�res" estimait que l'Eglise
anglicane avait trahi la foi biblique. Il refuse les titres
eccl�siastiques et constitue un ensemble de groupes �vang�liques
conservateurs, influenc�s par J. N. Darby et sa th�ologie "dispensationnaliste".
7. M�thode d'�tude de la bible typique du protestantisme lib�ral,
remontant � Schleiermacher (1768-1834) et issue de la philosophie
des Lumi�res du dix-huiti�me si�cle. Elle se signale notamment par
son �limination du surnaturel et son abandon de la notion de
dogme.
8. Keele est un centre universitaire � Newcastle-under-Lyme dans
le comt� de Staffordshire, entre Manchester et Birmingham.
9. J.C. Ryle (1816-1900), �v�que anglican de Liverpool de 1880
jusqu'� sa mort, �tait un fid�le pr�dicateur et un ferme d�fenseur
de la foi biblique.
10. J. H. Newman (1801-1890) intellectuel de tr�s grand talent,
th�ologien et po�te, est la figure la plus prestigieuse du
Mouvement d'Oxford. Accueilli dans l'Eglise catholique en 1845, il
a �t� nomm� cardinal en 1879. En 1991, le Vatican l'a d�clar�
"V�n�rable", ce qui est le premier stade de la canonisation par
l'Eglise romaine.
11. Commission qui travaille depuis 1967 � la restauration de la
pleine unit� entre l'Eglise catholique et l'Eglise anglicane,
c'est-�-dire au retour de cette derni�re au catholicisme romain.
Elle regroupe des membres du "Conseil Consultatif Anglican" et du
"Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unit� des Chr�tiens".
Voir sur le site du Vatican
12. Le Concile de Trente, qui si�gea de 1542 � 1563, constitue la
r�ponse officielle de l'Eglise catholique au mouvement de la
R�forme. Par exemple, au principe biblique du salut par la foi
seule en Christ seul, il oppose ses "D�crets sur la
Justification": "Si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est
autre chose que la confiance en la divine mis�ricorde, qui remet
les p�ch�s � cause de J�sus-Christ; ou que c'est par cette seule
confiance que nous sommes justifi�s: qu'il soit Anath�me
maudit."
(6e session, chapitre 16, canon XII, 13 janvier 1547). Rappelons
que tous les �v�ques ayant particip� � Vatican II ont jur�
fid�lit� � toutes les d�clarations du Concile de Trente.)
13. John Stott, n� en 1921, fut longtemps consid�r� comme le chef
de file des Evang�liques anglicans. Aum�nier de la reine Elizabeth
II de 1959 � 1991, tr�s respect� au Royaume-Uni, il est surtout
connu en France pour son ouvrage "L'essentiel du christianisme"
("Basic Christianity"). Il a maintenant abandonn� la doctrine des
peines �ternelles et a adopt� l'annihilationnisme.
14. En fran�ais: "Evang�liques et Catholiques ensemble". Document
publi� aux Etats-Unis en 1994 par un groupe de th�ologiens
�vang�liques et catholiques tr�s en vue. Ils se reconnaissent
r�ciproquement en communion spirituelle pour l'essentiel, et
�tablissent une collaboration sur le plan social et politique.
15. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) avait d�laiss� une brillante
carri�re m�dicale pour devenir pasteur et enseignant de la Parole
de Dieu. Il est consid�r� comme l'un des principaux d�fenseurs de
la foi biblique au 20e si�cle.
16. James I. Packer (n� en 1926), th�ologien anglais tr�s
influent, membre de l'Eglise anglicane. D'abord connu pour sa
position fermement �vang�lique, J. Packer soutient � pr�sent le
mouvement �cum�nique.
17. Les Trente-neuf Articles: Confession de foi conforme aux
doctrines de la R�forme, officiellement adopt�e par l'Eglise
d'Angleterre en 1563. Pour l'essentiel elle avait �t� r�dig�e par
l'Archev�que anglican Thomas Cranmer d�s 1552. Sous le r�gne de
Marie Tudor, Cranmer est mort pour sa foi sur le b�cher en 1556.
18. L'�v�que anglican Hugh Latimer, th�ologien � Oxford, �tait
pass� du catholicisme � la foi r�form�e. Sur le point d'�tre br�l�
vif � Oxford en 1555 sur le m�me b�cher qu'un autre �v�que de son
�glise, son ami Nicholas Ridley, pour avoir refus� d'abjurer la
foi biblique, il a adress� � ce dernier ces paroles �mouvantes:
"R�jouissez-vous, Ma�tre Ridley, montrez que vous �tes un homme.
Je crois fermement qu'aujourd'hui, par la gr�ce de Dieu, nous
allumons en Angleterre une flamme qui plus jamais ne s'�teindra."
19. En fran�ais: "Eglises ensemble en Angleterre". Mouvement "de
partenariat" entre �glises, inaugur� le 1er septembre 1990.
L'Eglise catholique et la plupart des d�nominations protestantes
en font partie.
20. Alphege (954-1012). Moine b�n�dictin qui devint Archev�que de
Cantorb�ry en 1005 et fut tu� par des envahisseurs danois. Il fut
canonis� par Rome en 1078.
21. Thomas Becket (1118-1170) devint Archev�que de Cantorb�ry en
1162. Il entra en conflit avec le roi Henry II � propos des droits
et des privil�ges de l'�glise. Il fut assassin� par des partisans
du roi au cours d'un office dans la cath�drale de Cantorb�ry le 29
d�cembre 1170. Plus tard Henry II fit publiquement p�nitence dans
l'�glise St Dunstan dans la m�me ville. Thomas Becket fut canonis�
en 1173.
22. A propos de Cranmer, voir note 17.
23. "The Book of Common Prayer", un recueil liturgique inspir� par
la foi r�form�e, et d� essentiellement � Cranmer, est depuis le
seizi�me si�cle l'ouvrage de base de l'Eglise anglicane.
Maintenant consid�r� par beaucoup comme trop rigoureux sur le plan
doctrinal, il tend � �tre remplac� par un autre recueil, le
"Common Worship".
24. John Foxe (1516-1587), �rudit chr�tien anglais, auteur d'un
c�l�bre recueil intitul� "The Book of Martyrs" (Le livre des
martyrs), paru en 1547. Foxe lui-m�me a �t� pers�cut� � cause de
sa fermet� dans la foi biblique.
25. Augustin (ou Austin: � ne pas confondre avec Augustin
d'Hippone.) Moine b�n�dictin envoy� en Grande-Bretagne en 596 par
le Pape Gr�goire 1er, dit le Grand. Il est mort � Cantorb�ry vers
605.
26. Selon une tradition qui remonterait au roi Edouard le
Confesseur au onzi�me si�cle (mais d�pourvue de preuves
historiques), l'un des titres de l'Angleterre serait "Dos Mariae",
"Dot de la Vierge Marie." Ceux qui aspirent � remettre ce titre �
l'honneur d�sirent faire de la v�n�ration de Marie un facteur
d'unit� pour l'Angleterre, et voir leur pays redevenir soumis �
l'Eglise catholique romaine.
27. Anne Widdecombe, n�e en 1947, a �t� Membre de la Chambre des
Communes pour le parti Conservateur, et s'est convertie au
catholicisme en 1993, quittant l'Eglise anglicane suite � la
d�cision par le Synode G�n�ral d'ordonner des femmes.
28. John Gummer: ancien ministre du Parti Conservateur dans le
gouvernement de John Major puis dans celui de Margaret Thatcher.
Il a �galement quitt� l'Eglise anglicane en 1993 suite a la
d�cision d'ordonner des femmes.
29. Alan Clark (1928-1999), fils de l'historien d'art c�l�bre
Kenneth Clark, eut une vie mouvement�e. Il s'est converti au
catholicisme tr�s peu de temps avant sa mort.
30. Charles Moore, n� en 1956. Journaliste et ancien r�dacteur du
quotidien "Daily Telegraph" (de 1995 � 2003). Il est l'auteur de
la biographie officielle de Margaret Thatcher.
31. "Bill of Rights": loi de 1689 d�terminant les droits du
citoyen anglais.
La version originale de cet article peut �tre consult�e �
l'adresse:
http://www.bereanbeacon.org/articles_pdf/foundations_underattack.pdf
[email protected]
Dorchester House Publications
P.O. Box Rickmansworth
Â
